Que m’a-t-on enseigné : à calculer les sections de béton et d’acier. Que m’a-t-on enseigné : à plier le carton et le papier. Après un passage par des classes préparatoires en filière mathématiques, j’étais déjà un peu séparée du monde qui se touche ou qui donne chaud et froid. Il y avait, à la place, la topologie, les endomorphismes, les espaces préhilbertiens. Une séparation du monde qui était pourtant assez belle. Elle faisait l’effet d’une altitude. L’effet d’une quête de signes d’un paysage déjà là, un paysage derrière le monde, un paysage de langage. Le langage aussi m’a composé une distance avec le monde. La poésie, depuis petite. Mais je ne crois pas devoir rejetter cette abstraction des mathématiques et du langage. Elle est une augmentation du réel. Ce n’est pas elle qui entre en compétition avec le réel, avec la matière. Le béton, lui, est une augmentation de la maquette en carton. Il m’a rendu la matière abstraite. Il m’a rendu la matière surface. Il m’a permis l’économie de quelques questions. A moi, les questions m’arrivent lentement. D’autant plus lentement que la matière avec laquelle je pense est plastique et accomodante. Pour faire le saut du carton au béton, il faut seulement passer par les cas de charge et les calculs aux eurocodes, finalement. Ce sont les cours de construction en métal qui m’ont qui m’ont le plus éveillée à l’ouvrage comme un ensemble de relations où les choses se touchent, se tirent et se poussent presque à l’œil nu. Mes maquettes en carton n’avaient jamais l’air finies. Elles avaient l’air d’une pensée qui commence. Si je n’avais pas de questions, je n’avais pas non plus de réponses.
Dans la littérature « grand public » de la construction et du design, il y a des mots qui construisent un rapport au monde de moins en moins intuitif. Ils confinent l’architecture à un niveau d’abstraction qui tient à la magie, du moins à un savoir technologique et exclusif. Des mots qui font faux-plafond. Derrière le smart, l’intelligent, le sans fil, c’est pourtant bien explicable : des kilomètres de câbles, partout. La rhétorique à l’oeuvre nous accoutume à percevoir le monde bâti de façon monolithique. Elle le ramène à une surface (pensez donc à la tablette du même nom) ou à un habillage. L’architecture contemporaine parle le même langage, quand elle se manifeste par des peaux artistiques avec lesquelles elle compte impressionner la rétine des citadins. L’artiste Gordon Matta-Clark, dont il est difficile de sélectionner quelques mots sans caricaturer la démarche, décrit dans les années 70 cette attitude collective qui relève de la passivité : « tout le monde accepte l’architecture comme quelque chose qui se regarde ». Quand il découpe des murs, quand il extrude des planchers, il redécouvre avec son public la structure et l’épaisseur du matériau de la ville.
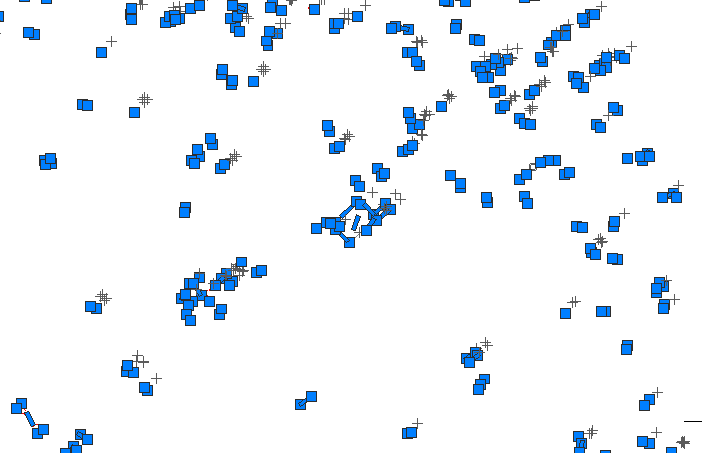
Occasionnellement, les travaux de Gordon Matta-Clark prennent comme matière la banlieue résidentielle. Il trouve un pavillon dont les occupants ont été chassés hâtivement en vue d’une prochaine rénovation urbaine. Il le coupe en deux (splitting, 1974). Et il fait cette remarque « (mon) travail réagit contre l’obsession hygiénique, qui, sous le nom de ré-urbanisation, anéantit le peu de passé étasunien qu’il reste pour tout purifier avec de l’acier et des parkings ». L’éloignement de l’habitant et de l’habitat ne date pas des articles qui prophétisent l’avènement de la smart city. La recherche de procédés de construction plus performants et standardisables a homogénéisé les pratiques constructives et les paysages. Ils bénéficient d’une sorte d’aura que n’ont pas les procédés vernaculaires, associés, dans certaines régions du monde, à la pauvreté. L’architecture aussi a son jeunisme. Propulsé par le prestige et la rapidité de mise en œuvre, le matériau « moderne » a remplacé des techniques pourtant très efficaces sous certains climats. Elle a contribué à faire de la maison occidentale un bien manufacturé. L’abri est une boîte étanche à l’air et à l’eau. Le confort thermique est délégué à un dispositif technologique embarqué (climatisation, chauffage). En Argentine, comme dans beaucoup d’autres régions, les maisons sont édifiées en blocs de parpaing et en tôle. Les habitants de ces constructions absurdements sensibles aux conditions extrêmes doivent recourir, selon la saison, à la climatisation et au chauffage. Pourtant, les matériaux alternatifs ne manqueraient pas. Dans cette région, pendant quelques jours en été, j’ai fait l’expérience d’une maison en terre crue. Le climat y était frais, sans climatisation. Mais la terre crue a la réputation d’un matériau archaïque, de l’auto-construction, donc, de la pauvreté. Et puis elle ne pardonne pas les défaut de conception et d’entretien. Elle donne des problèmes qu’on pense qu’on ne saurait plus résoudre. Mais à vouloir résoudre tous les problèmes de la même manière, on habite tous de la même manière. Je laisse ici Matta-Clark, car il n’aime pas les architectes qui cherchent à résoudre des problèmes. Dans un court recueil de conférences, un peu désarçonnant, intitulé « idées pour retarder la fin du monde », Ailton Krenak, figure de la lutte des peuples autochtones du Brésil, rejette le concept d’une seule « humanité » qui relève, selon lui, d’une « monoculture généralisée » portée par un « récit globalisant et superficiel ». Lui nous invite à créer des récits multiples pour habiter le monde. Nous voulons pour nous des outils pour ne pas résoudre tous les problèmes de la même manière.
J’ai lu plusieurs tribunes de revues spécialisées dans lesquelles la qualité de l’architecture et les labels sont alternativements soupesés. Cela met de la nuance dans le vocabulaire d’expressions toutes faites qui pullulent. Ce sont celles-là qui génèrent une sorte d’éblouissement et de passivité. L’architecture comme quelque chose qui se regarde, et qui, maintenant, s’étiquette, se labellise. Ce qui ressort de ces tribunes, malgré tout, c’est la nécessité des étiquettes pour inciter. En revanche, il ne faut pas occulter ce qu’Iwona Buczkowska appelle le « plaisir d’habiter » dans une texte pour SIGNE, la revue en ligne du Pavillon de l’Arsenal. Ou ce que Sophie Berthelier veut labelliser « HQA : Haute Qualité Architecturale » dans la revue Archistorm. C’est peut-être aller un peu loin que de poursuivre la logique du label, du prix, de la distinction, pour une qualité qui relève de la raison d’être du métier de l’architecte. Mais c’est mettre les choses dans le bon sens que de réaffirmer que la lumière, la matière, le confort thermique, sont au cœur du bien habiter. Lewis Mumford écrit de manière un peu affligée sur le New York des années 1950 : « malheureusement, l’architecture n’est pas l’art d’élever une façade » (heureusement pour mes maquettes pas finies et sans façade). Dans un chapitre du « Piéton de New York » qu’il intitule « la grande misère des riches », il poursuit : « Permettez-moi d’expliquer ce qui me paraît être le minimum de qualités que n’importe qui doive attendre d’un logement. Qu’il s’agisse d’une maison particulière ou d’un immeuble de trente étages, il faut d’abord exiger de l’air et de la lumière dans chaque pièce. Les pièces où l’on vit le jour doivent être orientées de façon à laisser pénétrer le maximum de soleil en hiver. (…) Pour assurer une provision suffisante d’air et de lumière, la distance entre les bâtiments doit être proportionnelle à leur hauteur. (…) L’espace entre les constructions doit être réservé à des jardins et à des pelouses, autant pour créer la beauté du site que pour adoucir la chaleur tropicale de nos étés et pour purifier et rafraîchir l’air ». A cet égard, le propos de l’architecte Philippe Rahm est intéressant : l’architecture comme art de la création des climats. Je cite aussi ce que dit le poète Philippe Jaccottet de sa maison en été : « une réserve d’ombre, une petite forteresse contre les armées solaires, un château d’eau, un château de fraîcheur » (La Semaison). Mon émerveillement le plus récent a été d’entrer dans la chambre Philippe Lesbahy du château d’Azay-le-Rideau, dans la Loire. Les murs étaient entièrement recouverts par des nattes de jonc tressé. Un dispositif d’isolation datant de la Renaissance et dont on ne trouve plus d’exemple en France. La lumière, l’odeur, la chaleur. Ce qu’on m’a dit à l’école d’architecture, c’est que l’architecte devait être généreux. Rozana Montiel, architecte mexicaine, dit « la beauté est un droit fondamental ». Elle cherche à transformer des programmes complexes en formes simples. Ses propositions font de l’espace pour la vie commune dans un contexte de surenchère de logement de masse et de crise d’espace public. Ses ouvrages sont simples, proportionnés, et, sans les avoir expérimentés, on est convaincu qu’ils fonctionnent. L’année dernière, dans le cadre de la biennale d’architecture et de paysage de Versailles, Rozana Montiel a donné une conférence qu’elle a nommée « caught in the act ». Pris(e) sur le fait, un peu comme la beauté.
Etre pris(e) sur le fait, c’est faire, déjà. Souvent on en a trop-plein dans les yeux et trop-peu dans les mains. Ou dans la tête. J’ai récemment fait la découverte de Ken Isaacs, architecte étasunien du XXe siècle. En proposant des plans-types de mobilier et de maisons modulaires, il veut remettre la fabrication de l’habitat dans les mains de l’habitant « j’ai toujours été un bâtisseur (…) et quand vous construisez des choses, ça vous change ». Faire de tout un chacun un bâtisseur accompli relève de l’utopie. Fabriquer des villes de cubes n’est peut-être pas très désirable. Mais il serait désirable que l’architecture puisse évoquer, pour tous ceux qui la vivent, des matériaux et des gestes. Qu’elle suggère le « faisable » (le mot est laid). C’est redoutablement difficile lorsqu’elle joue à s’envelopper ou à se monumentaliser. En fait, même les concepteurs semblent s’éloigner de leurs ouvrages. La complexité du montage des projets de construction ne doit pas y être pour rien. Des spécialistes étudient les ouvrages petit bout par petit bout sous la houlette de chefs d’orchestres un peu dépassés par la gestion des contrats et des limites de responsabilité. Tout ce petit monde est-il un collectif ou est-ce un collage ? Une erreur de conception tourne vite au défaussement de chacun sur le voisin d’à côté. Quand les missions sont morcelées à ce point, seule la mise en place d’une démarche de gestion des risques (et donc, la peur, si je caricature) semble pouvoir obliger tous les intervenants à partager les objectifs d’un projet. Un volume de missions qui s’accroît éloigne facilement le donneur d’ordre de son chantier. Je travaille aujourd’hui comme assistance à maîtrise d’ouvrage. La sécurité des ouvriers est ce qui permet heureusement aujourd’hui de maintenir une conscience du geste physique de la construction. Le geste qu’on ignore, quelque part, fait partie de la maquette qui n’est pas finie. La matière qu’on ignore aussi.
Je ne regrette pas mes études. Mais, alors que j’ai suivi deux cursus complémentaires, d’ingénieure en bâtiment et d’architecte, en cinq ans, j’ai eu le sentiment d’une connaissance trop parcellaire. J’ai pu croire que je n’avais pas assez bien compris comment unir le « paysage » de ce qu’on m’avait enseigné. L’espace, le carton, les calculs aux eurocodes, le béton. J’essaie lentement de reconstituer ce qui pourrait joindre ces fragments à d’autres. Reconstituer un arrière-plan qui serait un peu comme celui que décrit le poète (encore un) Rilke « une fois qu’on a découvert la mélodie de l’arrière-plan, on n’est plus indécis dans ses mots ni obscur dans ses décisions ». Attirée, petite, par des campagnes de fouilles, j’ai souhaité devenir archéologue, avant d’être architecte. J’ai évoqué devant mon jury d’admission en double cursus ingénieur-architecte mon goût pour le patrimoine. J’ai senti en retour une sorte de mise en garde, comme si l’architecte contemporain ne devait rien avoir à voir avec l’architecte de la vieillerie. Effectivement, l’enseignement des modes constructifs antérieurs au XXe siècle est confiné au cursus de spécialisation des architectes du patrimoine. Un de mes amis apprend à l’école de Chaillot comment faire un mur de pierres qui durera plus de cent ans, et, curieusement, c’est moins abstrait. Les pierres d’une ville fabriquent sa lumière. Elles recomposent les pans d’un paysage déjà là. Heureusement, j’ai encore le temps d’apprendre. J’aime cette phrase de Philippe Jaccottet : « on peut encore à tout moment modifier la vie avec beaucoup d’attention et de douceur ».
L’origine de ce texte est une lettre de candidature rédigée il y a un an, en vue d’être admise à un programme de cours, de visites et de workshops autour du matériau pierre, créé par une fondation d’entreprise française et encadré par l’architecte Lina Ghotmeh.
